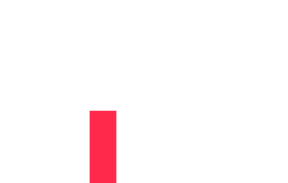Sommaire
Répondre aux fractures alimentaires et réduire les aliments ultra-transformés
La France connait depuis quelques années, un contexte inflationniste fort, marqué notamment sur le secteur alimentaire. Ce contexte a renforcé les fractures alimentaires entre français, comme le montre l’Institut Montaigne, dans son rapport de 2024 auquel iQo a participé.
Sur le plan social, la crise inflationniste a accentué une situation déjà préoccupante en matière d’accès à l’alimentation. Face à des dépenses contraintes grandissantes – logement, énergie, transports – l’alimentation est devenue la variable d’ajustement budgétaire des ménages les plus modestes. Un Français sur trois est aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire
Rapport Fracture Alimentaire, Institut Montaigne, 2024
Un recours croissant aux aliments ultra-transformés
Ainsi, les données de l’ANSES (étude INCA 3) montrent que les aliments ultra-transformés représentent :
- 30 à 35% des apports énergétiques des adultes français, particulièrement marqué chez les personnes issues de catégories socio-économiques les plus faibles.
- Jusqu’à 45 % chez les adolescents.
Ce recours aux produits ultra-transformés est en outre plus fort dans les zones urbaines, au sein des ménages modestes ou pressés par des contraintes de temps.
Dans les linéaires de la grande distribution, on estime que 60 à 70 % des références concernent aujourd’hui des produits ultra-transformés.
Largement répandue dans les chaînes de production agroalimentaire, cette transformation poussée des aliments constitue aujourd’hui un angle mort de la régulation, malgré des enjeux sanitaires, économiques et industriels de premier ordre.
Des politiques nutritionnelles ciblées mais incomplètes pour réduire l'ultra-transformation alimentaire
Les initiatives publiques en matière d’alimentation – NutriScore, Éco-Score, PNNS – ont principalement ciblé la composition nutritionnelle des produits (graisses, sucres, sel) ou leur impact environnemental. Plus récemment, l’Institut Montaigne a proposé une taxe sur les sucres ajoutés, dans une logique de dissuasion économique. Mais aucun de ces dispositifs n’intègre aujourd’hui la transformation industrielle des aliments comme critère d’évaluation autonome.
Les études scientifiques confirment les impacts négatifs des aliments ultra-transformés sur la santé
Pourtant, les études scientifiques convergent. Des recherches publiées par l’INSERM, INRAE ou Harvard School of Public Health démontrent un lien clair entre consommation régulière d’aliments ultra-transformés (AUT) et augmentation du risque de pathologies chroniques (obésité, maladies métaboliques, troubles cardiovasculaires). À ces effets sanitaires s’ajoutent des coûts indirects importants pour le système de santé publique.
Chaque année, de nouvelles études scientifiques jettent une lumière défavorable sur des substances présentes dans de nombreux produits ultra-transformés. Après le débat sur les sels nitrités (présents dans la charcuterie industrielle) ou les édulcorants artificiels, c’est aujourd’hui le soja (dans ses formes ultra-raffinées ou texturées) ou les agents de fonte dans les fromages qui font l’objet de controverses. Ces mises en cause répétées créent une pression d’image croissante pour les marques, qui se retrouvent exposées aux critiques des consommateurs et à une défiance médiatique.
Trois enjeux à fort impact de l'ultra-transformation alimentaire : économie, santé et réputation
Réduire l’ultra-transformation n’est pas uniquement un objectif de santé publique : c’est aussi une décision stratégique à plusieurs niveaux.
- Économique : la transformation industrielle s’appuie sur des chaînes complexes – standardisation des recettes, procédés techniques, contrôles qualité, packaging adapté, logistique optimisée. Revenir à des recettes plus simples peut, à terme, permettre de réduire certaines étapes coûteuses (notamment en additifs, équipements, ou contrôles) et faciliter une relocalisation partielle des filières.
- Sanitaire : en intégrant la transformation comme variable d’action publique, les pouvoirs publics disposent d’un levier complémentaire aux politiques nutritionnelles classiques, capable de mieux rendre compte de la qualité globale de l’alimentation, à nuancer par l’impact potentiel de la réduction des additifs sur certains contaminants (ex. : listeria, botulisme, …).
- Réputation et image de marque : chaque controverse sur une substance (sel nitrité, soja texturé, édulcorants artificiels...) génère une onde de choc. Les entreprises qui n’anticipent pas ces mouvements d’opinion s’exposent à une perte de confiance de leurs consommateurs. Inversement, celles qui réduisent volontairement leur niveau de transformation valorisent leur image, sécurisent leurs relations avec la distribution et s’alignent avec les attentes des consommateurs.
Un potentiel économique et industriel sous-estimé
Inclure le degré de transformation dans les politiques alimentaires permettrait de dépasser une lecture strictement nutritionnelle ou environnementale de la qualité des produits. Il s’agirait ainsi de construire une approche plus systémique, intégrant la nature des procédés industriels comme variable explicative du risque sanitaire, de l’impact environnemental et du coût sociétal.
Cela pourrait aussi ouvrir la voie à une forme de relocalisation qualitative : les produits moins transformés sont généralement moins dépendants d’ingrédients importés ou synthétiques, plus adaptés aux circuits courts, et souvent plus faciles à aligner sur les attentes croissantes des consommateurs (naturalité, transparence, simplicité).
Des freins à lever : structure du marché et cadre réglementaire
Malgré ce potentiel, plusieurs obstacles freinent une transition vers des produits moins transformés.
- Le premier est réglementaire : la définition même de l’ultra-transformation reste sujette à débat. Le système de classification NOVA, aujourd’hui la référence scientifique, n’est toujours pas intégré aux cadres réglementaires européens ou français. Cela empêche son utilisation dans les dispositifs d’affichage (comme le Nutri-Score) ou dans les critères d’aide publique à l’innovation alimentaire.
- Du côté industriel, les résistances sont structurelles. L’ultra-transformation est un modèle d’optimisation de la chaîne de production, avec des formulations standardisées, des durées de conservation étendues et des coûts unitaires réduits. Les procédés associés (homogénéisation, extrusion, ajout d’additifs, retexturation) permettent une gestion fine des rendements, des stocks et de la qualité perçue. Revenir à des produits moins transformés signifie remettre en question ces équilibres. Cela implique des investissements en R&D, des ajustements sur les lignes de production, un nouveau sourcing d’ingrédients plus bruts, souvent plus chers et plus périssables, et une redéfinition du marketing produit.
Pour autant, continuer à s’appuyer massivement sur l’ultra-transformation revient à externaliser une partie du coût : sanitaire (à travers le système de soins), environnemental (importation d’ingrédients synthétiques ou exotiques) et réputationnel (crises liées aux additifs ou pratiques industrielles). La question n’est donc pas seulement technique, elle est aussi stratégique.
Quels leviers d’action pour les industriels pour réduire l'ultra-transformation alimentaire ?
- Cela suppose d’intégrer les enjeux de transformation dans leur plan stratégique, au même titre que la transition écologique ou la digitalisation, d’anticiper les évolutions réglementaires potentielles en s’alignant volontairement sur les critères émergents (NOVA, clean label, ingrédients naturels), ou encore, de repositionner leur image de marque en valorisant la naturalité, la simplicité des recettes et la transparence des procédés.
- D’un point de vue métier, repenser à la fois l’innovation produit et les modes de production semble être un indispensable. Cela passe par des formulations plus simples, sans additifs controversés, et l’usage de procédés plus doux (fermentation, cuisson lente, haute pression). En parallèle il convient d’adapter son sourcing vers des ingrédients plus bruts et locaux, et rendre les lignes de production plus flexibles pour gérer des matières premières moins standardisées.
- Les équipes marketing et communication auront la mission de valoriser les efforts de simplification (clean label, naturalité, transparence) et accompagner le client et le consommateur dans cette évolution sans culpabilisation. En parallèle, les industriels doivent agir collectivement avec les distributeurs, les startups innovantes, les filières agricoles et les pouvoirs publics pour construire des standards clairs, partager les bonnes pratiques et accélérer la montée en gamme de l’offre.
Conclusion
L’ultra-transformation des aliments constitue un enjeu stratégique encore peu adressé dans les politiques alimentaires françaises. En l’intégrant dans les outils de mesure, d’incitation et de régulation, il serait possible d’améliorer la qualité globale de l’offre alimentaire, de stimuler l’innovation responsable dans l’industrie agroalimentaire, et de mieux répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de santé, de naturalité et de confiance.
Mais cette transition ne se fera pas sans soutien public. Aujourd’hui, les comportements alimentaires sont marqués par des contraintes fortes : moins de temps pour cuisiner, recherche de praticité, pression budgétaire. Dans ce contexte, les produits ultra-transformés conservent un avantage compétitif. Sans incitation forte à transformer le modèle industriel – aides à la R&D, fiscalité différenciée, information du consommateur – le changement restera marginal.

Évaluation EcoVadis : iQo obtient la certification Gold pour sa stratégie RSE
EcoVadis Gold pour nos engagements RSE avec un score de 82/100. Nous sommes fiers de partager avec vous cette distinction décernée par EcoVadis. Ainsi, elle place iQo parmi les 2%
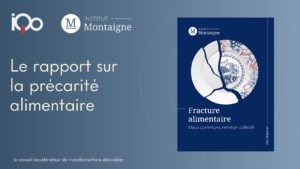
Fracture alimentaire : le rapport de l’Institut Montaigne
Fruit d’une analyse collégiale, à laquelle a participé iQo, découvrez le rapport complet sur la Fracture Alimentaire de l’Institut Montaigne. Sommaire Présentation du rapport Fracture Alimentaire La France face à
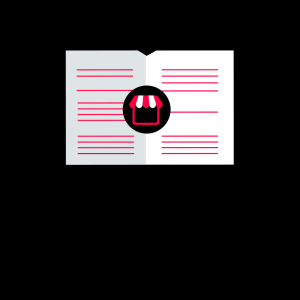
NumAlim ou comment rendre plus transparentes les informations nutritionnelles
4 000 produits déjà référencés sur NumAlim (fin 2021), 250 000 références attendues et 25 millions de données agrégées en 2023 : les ambitions de la plateforme NumAlim, officiellement mise